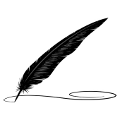Elias - 2
Elle se réveilla en sueur et se redressa sur son lit. Son cœur battait si vite qu’il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Le souffle court, elle attrapa du bout des doigts son coussin, le tira vers elle d’un coup sec et le serra dans ses bras. Inspire. Elle prit une inspiration un peu plus longue, la mâchoire crispée, les yeux fermés de douleur. Expire. Elle se força a souffler l’air de ses poumons, et ses pensées se calmèrent un peu. Elle refit l’exercice et son visage commença à se relâcher. Inspire, expire, dedans, dehors, bleu du ciel, nuage gris, prends de l’oxygène, souffle du dioxyde de carbone, lentement, lentement. Son cœur ralentit aussi, et elle put ouvrir les yeux. Il faisait nuit.
Trois jours. Trois jours qu’elle se réveillait de la sorte, que son angoisse lui nouait le ventre. Trois jours qu’elle avait reçu la lettre de lui. Son père. Une simple feuille A4, qui lui disait d’abord avec douceur qu’il espérait que sa vie lui plaisait, et qu’il comprenait son choix. Plus loin, le sujet changeait radicalement : il déclarait en quelques lignes l’épidémie qui sévissait le long du Léman, comment sa femme et lui étaient tombés malades, comment elle y avait succombé. Il annonçait qu’une cérémonie avait eu lieu dès qu’il en avait eu les forces, qu’avec la distance ça n’aurait servi à rien de la prévenir avant, et qu’il avait survécu à cette vague d’épidémie. Ensuite, il avait cessé d’écrire à l’encre - comme pour espérer que le crayon s’efface et la réalité avec – pour préciser que sa santé s’aggravait à cause d’un cancer et qu’il n’en aurait sûrement plus pour longtemps. Il terminait la lettre en ces termes :
«Je suis fier de toi ma licorne. Tu as su te faire ta place dans ce monde et, malgré nos différences, saches que je ne t’en veux pas pour nos engueulades. Je sais que le déplacement ne te seras pas possible. Je te laisse une boîte dans le coin de ta chambre si tu venais à repasser par là. Au revoir.»
Comment dormir après ça ? Sa mère était morte, son père le serait avant qu’elle ne puisse le revoir. Leur dernière discussion était une engueulade. Chaque nuit elle faisait des cauchemars dans lesquels elle voyait ses parents dans un cercueil, la ville de son enfance brûlant derrière eux et des personnes cadavériques autour l’encourageant à rejoindre sa famille en se glissant dans cette boîte en bois. Chaque matin elle se demandait s’il fallait tout quitter pour espérer revoir son père, avec aucune garantie d’y arriver en vie ni de le voir, et encore moins de pouvoir continuer à vivre ensuite. Ici au moins elle avait un travail qui lui offrait la protection d’une ville gardée, et de la nourriture. Elle avait pleuré en lisant cette lettre, et pleuré pendant les jours et les nuits qui avaient suivi.
Elle reposa son coussin et se leva, fit quelques pas vers la fenêtre en évitant la table qui trônait au centre de la pièce et en attrapant au passage un grand livre qui était posé dessus. En arrivant contre la vitre, elle contempla les bâtiments alors que la nuit commençait à s’éclaircir, créant des nuances de gris sur les façades. Les enseignes étaient seules témoins de couleurs amenées par des humains dans ces rues monotones, tout le reste n’était que routes grises, trottoirs gris, murs gris et nuages à leur image. Le béton avait tout englouti. Elle ouvrit son livre, rempli d’images et d’histoires sur Morat avant la dernière guerre mondiale, feuilleta quelques unes de ces pages qu’elle connaissait bien et s’arrêta sur sa préférée : la plage. Cette photo était un concentré de vie, figé sur papier. Au premier plan, un groupe d’enfants jouant dans l’herbe à se courir après en riant. Derrière eux, des planches à voiles s’amusant dans le vent qui soulève des vagues écumeuses et les renverse parfois. Sur la droite, quelques beaux arbres proposent leur ombre à une famille profitant de l’espace et de la météo pour un pic-nique sur une grande nappe à carreau, où les parents étalent les assiettes et bols de salade colorée, de tartinades variées, de biscuits et de fruits découpés. Caroline saliva rien qu’à en voir les couleurs. Elle avait tellement rêvé de moments comme celui-ci en famille. Une larme coula le long de sa joue. Tout au fond, derrière le lac, on voyait une colline verdoyante où l’on devinait de nombreux oiseaux, rongeurs, cervidés et autres animaux se déplaçant, chantant, vivant.
Coralie jeta un œil par-dessus les pages de son livre. En tendant le coup, elle apercevait une fine bande de lac gris entre ces bâtiments ternes. La colline et sa forêt semblaient bien différentes depuis que le lac était entièrement pollué. Les arbres secs au bord de l’eau n’accueillaient plus ni oiseau ni insecte. Les algues vertes avaient proliféré, un temps, jusqu’à ce que même elles ne puissent survivre dans cette eau. En se décomposant, elles avaient rendu les berges particulièrement toxiques et la masse noirâtre qui restait empestait le souffre, ainsi qu’un mélange tiré du concentré de déchets des entreprises locales. Aujourd’hui, personne n’osait laisser des enfants jouer au bord du lac sauf si l’on manquait de nourriture pour eux. C’était une condamnation.
Une alarme sonna l’heure à laquelle elle aurait dû s’éveiller. Elle parcouru la pièce des yeux et tomba sur sa tasse où stagnait un reste de café de glands froid. Elle laissa le livre sur la table, alla chercher sa tasse pour se faire infuser un autre café, jetant machinalement le liquide froid dans l’évier. Sa préparation pour aller travailler se fut avec autant d’énergie qu’un panneau solaire la nuit. Quand le soleil fut clairement levé, elle attrapa son masque, sortit et se dirigea en traînant les pieds vers le centre de la ville où se dresse son usine : un gigantesque bloc de béton armé, avec des cheminées dressées vers le ciel. Crachant des fumées toute la journée, elles se refusait à l’idée que ces cheminées étaient la seule source des nuages. Pourtant, sous un ciel toujours gris, il ne pleuvait presque jamais.
La journée passa aussi lentement que prévu. Ses pensées alternaient de ses parents à son travail et plus elle y pensait, moins elle était capable de réaliser les quelques transformations chimiques dont elle était responsable. Elle prit une pause avant midi pour se vider la tête, avant que son inattention ne devienne un danger pour elle ou l’usine. Dans les couloirs, elle faisait les cent pas entre les murs blêmes, s’asseyait, se relevait, recommençait à marcher, jusqu’à ce qu’elle eut mal aux pieds.
De retour au laboratoire alors que l’heure de la pause sonnait, elle ouvrit un carnet qu’elle se forçait à remplir tous les jours depuis son arrivée à l’usine. Elle y retrouvait des condensés de rage, d’espoir d’une nouvelle vie, d’ennui, de dépression et aujourd’hui de tristesse. Elle avait l’habitude de le feuilleter parfois, mais de surtout écrire. Aujourd’hui, sans savoir pourquoi, elle avait envie de lire. Reprenant au début, elle se lança dans la recherche de ses émotions avec une question en tête : avait-elle été heureuse ici ?
C’était un jour de congé pour les deux autres personnes de son laboratoire, le labo était vide. Elle lu pendant des heures. Page après page, elle notait dans la marge l’émotion qu’elle avait couchée sur papier ce jour-là.
Fierté. Rage. Tristesse. Espoir. Découverte. Reconnaissance. Peur. Lutte. Envie. Réussite. Colère. Épuisement. Solitude. Tristesse.
C’en était presque effrayant. Elle n’avait pas eu une seule journée de bonheur dans ce lieu. Pas une. Elle avait ramené son carnet chez elle pour terminer la lecture une fois ces heures de travail passées et ses paupières commençaient à se faire lourdes. Pourtant ce constat la réveilla. Ce n’était pas que ces derniers jours qui étaient empreints de malheur, mais bien un thème récurent. Elle se rappela de son enfance avec ses parents, de ses joies, de ces moments de rire qui parsemaient un jour son quotidien. Elle se rappela aussi de ses camarades de jeu. Des souvenirs brillants lui revenaient à la tête et elle se sentit d’autant plus seule, dans une ville d’autant plus triste, grise, malheureuse. Elle fondit en larmes sur son lit.
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire